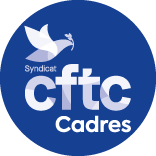Lanceurs d’alerte : va-t-on enfin vers une protection efficace ?
En France, le statut des lanceurs d’alerte est régi par la loi Sapin II[1]. Cette loi a permis de combler un déficit de protection pour les lanceurs d’alerte et d’importantes avancées en matière de lutte contre la corruption mais elle reste trop peu souvent mobilisée. Dans la fonction publique, la « culture » de l’alerte était déjà plus développée, notamment grâce au mécanisme de l’article 40 du Code de procédure pénale qui oblige tout officier public ou fonctionnaire ayant connaissance d’un crime ou d’un délit d’en aviser le procureur de la République.
Souvent présenté en exemple, le modèle français est pourtant bien moins protecteur que les législations américaines et anglaises sur lesquelles de nombreux pays se sont depuis alignés. Le peu de succès rencontré par le dispositif français tient essentiellement à sa complexité et au fait qu’il expose les lanceurs d’alerte à un risque juridique et financier important. Par ailleurs, les moyens consacrés au recueil et au traitement des alertes sont encore insuffisants, tout comme l’accompagnement des auteurs de ces signalements.
Une culture de l’alerte encore à construire
Le retard de la France pour reconnaître un droit de dénoncer, hors du cadre judiciaire classique, des faits illégaux peut s’expliquer historiquement par le traumatisme des délations durant l’Occupation. Aux Etats-Unis, le droit d’alerte a été consacré dès le 19ème siècle afin de lutter contre la fraude dans les marchés publics. Depuis 1863, tout citoyen ayant connaissance d’une fraude au détriment de l’Etat fédéral peut intenter une action en justice en son nom, même s’il n’a pas directement un intérêt à agir. Il peut également recevoir en compensation, et à titre d’incitation, une part du recouvrement. Rien qu’entre 2009 et 2012, ce dispositif a permis de collecter plus de 13 milliards de dollars. D’autres mécanismes apportent une protection pour les lanceurs d’alerte contre des représailles ou imposent explicitement, dans le secteur privé, de signaler toute fraude. Depuis 2010, les lanceurs d’alerte fournissant des informations permettant de sanctionner des illégalités reçoivent même entre 10 et 30 % de l’amende si ce montant dépasse un million de dollars[2].
En Angleterre, les lanceurs d’alerte font l’objet d’une protection spécifique depuis la fin des années 1990 grâce au Public Interest Disclosure Act (PIDA) qui a d’ailleurs inspiré d’autres pays, notamment l’Irlande qui offre une immunité civile aux lanceurs d’alerte et un régime favorable en cas de poursuites en diffamation.
La France, qui ne connaissait que des dispositifs épars, par exemple en matière de protection de l’enfance et de lutte contre les maltraitances[3], de droit d’alerte du CHSCT en cas de danger grave et imminent[4] ou encore en matière de signalement de situation de discrimination ou de harcèlement au travail[5], était donc particulièrement en retard sur ce sujet. Méconnus et peu clairs, tous ces dispositifs étaient finalement très peu utilisés et les signalements restaient rares, tant dans le secteur public que privé.
Pourquoi protéger les lanceurs d’alerte ?
Contrairement aux perceptions négatives, le lanceur, par son action désintéressée, permet la prévention ou la révélation de failles et de dysfonctionnements graves dans nos entreprises, administrations ou institutions. Fondée sur deux libertés fondamentales : la liberté d’expression et le droit à l’information, l’alerte éthique est elle-même au service de droits fondamentaux tels que le droit à un environnement sain, le droit à l’information, à la santé, à la non-discrimination etc. A cet égard, le lanceur d’alerte est un vecteur de la moralisation de la vie publique et économique et, en participant à faire disparaître des pratiques illégales et allant à l’encontre de l’intérêt général, il permet de donner confiance dans les entités publiques ou privées.
Loin des cas très médiatiques tels qu’Edward Snowden ou Erin Brockovich, un lanceur d’alerte peut tout simplement être ce cadre d’une filiale de la SNCF qui a refusé de fermer les yeux concernant des actes de malversations, de corruption et de trafic d’influence. Il a dans un premier temps averti sa hiérarchie, laquelle a ignoré ses alertes pendant plusieurs années, avant de saisir les autorités compétentes. Bien que les faits dénoncés aient fait l’objet d’en enquête préliminaire du Parquet national financier, ce cadre a subi les représailles de son employeur : affectation à un autre poste, détachement provisoire, retrait des listes d’information, exclusion du réseau, suppression des données personnelles, sanctions disciplinaires, mutations multiples puis licenciement.
 Le lanceur d’alerte peut aussi être cette salariée d’une entreprise de traitement et revêtement des métaux, responsable qualité sécurité et environnement et représentante du personnel qui a été licenciée après avoir averti la direction régionale de l’environnement d’une pollution imminente alors que son entreprise envisageait de déverser des déchets toxiques dans les eaux pluviales, et à proximité d’une crèche.
Le lanceur d’alerte peut aussi être cette salariée d’une entreprise de traitement et revêtement des métaux, responsable qualité sécurité et environnement et représentante du personnel qui a été licenciée après avoir averti la direction régionale de l’environnement d’une pollution imminente alors que son entreprise envisageait de déverser des déchets toxiques dans les eaux pluviales, et à proximité d’une crèche.
C’est principalement pour éviter ce type de représailles qu’il est nécessaire d’avoir un statut protecteur pour les lanceurs d’alerte.
La loi Sapin II, première étape dans la protection des lanceurs d’alerte
La principale avancée de la loi Sapin II a été de proposer une définition globale des lanceurs d’alerte et de regrouper l’ensemble des alertes[6] existantes, offrant ainsi un cadre unifié et plus clair aux signalements. Ce cadre juridique moins éclaté pour les lanceurs d’alerte a permis d’étendre le champ des secteurs concernés et de mieux faire connaître le statut. Sans être parfait, il a le mérite de simplifier les critères d’éligibilité à la protection, d’encourager et de poser un processus pour les signalements.
Les faits pouvant faire l’objet d’un signalement – et donc être qualifiés d’alerte – ont été largement élargis par la loi Sapin II. Ces faits peuvent concerner des champs particulièrement vastes : crime, délit, activité gravement contraire à l’intérêt général dans tous les domaines : santé, environnement, économie, corruption, discrimination et harcèlement au travail, violation des droits de l’homme, fraude, délit d’initié, utilisation abusive de données etc.
Un niveau de protection théorique élevé pour les lanceurs d’alerte
L’objectif principal d’une législation sur les lanceurs d’alerte est de leur offrir une protection face à des risques de représailles : attaque en diffamation, sanction de l’employeur, perte d’emploi, vie privée exposée… Pour s’en prémunir, est par exemple prévue l’immunité pénale pour les lanceurs d’alerte qui peuvent s’en prévaloir si leur signalement les a conduit à enfreindre un secret protégé. Cela permet notamment de prévenir la pratique du « bâillon » qui consiste à multiplier les plaintes à l’encontre du lanceur d’alerte afin d’entraver son signalement. La loi prévoit également l’interdiction de représailles sous forme de sanction ou de discrimination à l’encontre des lanceurs d’alerte en entreprise[7] et dans la fonction publique[8]. Enfin, l’anonymat du lanceur d’alerte et de la personne qu’il vise est préservé par une forte sanction en cas de divulgation d’éléments permettant de les identifier.
Mais des conditions trop strictes pour en bénéficier
Si la protection des lanceurs d’alerte a bien progressé, il reste encore trop difficile d’en bénéficier tant le régime instauré par la loi Sapin II impose des conditions strictes.
En effet, le lanceur d’alerte ne peut être protégé que s’il s’agit d’une personne physique qui a personnellement connaissance des faits. Sont donc exclues du statut celles informées par un lanceur d’alerte et les personnes morales comme un syndicat ou une association.
Par ailleurs, pour bénéficier de la protection, le signalement doit être désintéressé, ce qui exclut les cas où le lanceur d’alerte est en conflit d’intérêt avec la situation qu’il dénonce (par exemple s’il s’agit de signaler un concurrent) ou s’il peut en tirer un quelconque bénéfice personnel. Évidemment, on est aux antipodes de ce qui existe aux Etats-Unis ou le lanceur d’alerte est rétribué en proportion des ressources qu’il a permis aux pouvoirs publics de collecter ou de préserver.
Enfin, la manière dont l’alerte doit être divulguée est très précise, voir pointilleuse, et n’autorise aucun écart. Trois canaux de révélation d’une alerte sont en effet organisés par la loi et leur hiérarchie doit être scrupuleusement respectée :
- un canal interne (supérieur hiérarchique direct ou indirect, employeur ou référent désigné)
- un canal externe confidentiel (autorité judiciaire, administrative ou ordre professionnel)
- un canal externe public (presse)
En France, le lanceur d’alerte doit nécessairement suivre un chemin tortueux et procéder à un signalement en interne en laissant un délai raisonnable à l’entreprise ou l’administration avant de se tourner vers une autorité externe en cas d’inertie. La divulgation publique de l’alerte ne peut se faire que trois mois après la saisine d’une autorité judiciaire, administrative ou d’un ordre professionnel et ça n’est qu’en cas de danger grave et imminent ou de risque de dommages irréversibles (dont l’appréciation sera âprement discutée) que le public peut être averti par exemple par voie de presse.
En l’état actuel de la législation, le droit d’alerte n’est donc pas un droit de dénoncer publiquement une infraction mais une incitation à procéder à des signalements internes ou – seulement lorsque cela est nécessaire – externes pour prévenir des incidents qui porteraient atteinte en profondeur à l’intérêt général.
De nombreux axes d’amélioration possibles
Sans une protection et un accompagnement renforcé, le signalement d’un crime ou d’un délit fait peser aujourd’hui une menace importante pour celui qui dénonce cette situation et qui risque de voir sa vie professionnelle mais aussi personnelle sacrifiée alors qu’il agit pour l’intérêt général.
Rappelons que les faits faisant le plus l’objet de signalements (autant dans le secteur public que privé) sont professionnels et concernent la corruption (32 %), les maltraitances ou violences institutionnelles (17 %), les risques sanitaires ou environnementaux (14 %), la discrimination, le harcèlement ou des problèmes de sécurité au travail (10 %)[9].
S’il nous apparaît normal d’exiger la bonne foi du lanceur d’alerte, exiger son désintéressement sera beaucoup plus contraignant et source d’insécurité juridique puisque cela va exclure certains lanceurs d’alerte d’une protection légitime. Il peut s’agir de personnes signalant un fait concernant une entreprise avec laquelle il se trouve en litige, même pour une autre raison, ou les cas où l’alerte peut, directement ou indirectement, lui bénéficier.
 De plus, la hiérarchisation des canaux de révélation pose un vrai problème en pratique. L’obligation de passer par un canal interne expose nécessairement le lanceur d’alerte à des représailles, laisse le temps aux organisations de dissimuler les alertes, voire de faire pression sur son auteur. On peut aussi s’interroger sur l’efficacité du signalement interne, faisant de l’entreprise à la fois juge et partie et plaçant le supérieur hiérarchique recevant l’alerte dans une situation inconfortable de conflit d’intérêt ou de loyauté vis-à-vis de sa propre hiérarchie. Finalement, cette obligation de signalement en interne constitue plus un frein aux signalements qu’un encouragement.
De plus, la hiérarchisation des canaux de révélation pose un vrai problème en pratique. L’obligation de passer par un canal interne expose nécessairement le lanceur d’alerte à des représailles, laisse le temps aux organisations de dissimuler les alertes, voire de faire pression sur son auteur. On peut aussi s’interroger sur l’efficacité du signalement interne, faisant de l’entreprise à la fois juge et partie et plaçant le supérieur hiérarchique recevant l’alerte dans une situation inconfortable de conflit d’intérêt ou de loyauté vis-à-vis de sa propre hiérarchie. Finalement, cette obligation de signalement en interne constitue plus un frein aux signalements qu’un encouragement.
L’accompagnement des lanceurs d’alerte en France est aussi à déplorer car il est encore quasi inexistant. Bien que cette mission soit dévolue au Défenseur des droits, cet organisme n’y emploie en effet qu’un seul équivalent temps plein quand les Pays-Bas consacrent par exemple 4 millions d’euros à l’accompagnement des lanceurs d’alerte.
Enfin, la protection juridique contre les risques de représailles mérite d’être largement renforcée puisque, pour exercer une alerte, le lanceur d’alerte est souvent contraint de soustraire des documents ou de les reproduire et peut être poursuivi pour vol ou recel. Ainsi, dans l’affaire LuxLeaks[10], le lanceur d’alerte a dans un premier temps été condamné pour vol par la justice luxembourgeoise avant que la Cour de cassation annule cette condamnation et reconnaisse à l’auteur de l’alerte le statut de lanceur d’alerte. En France, la création de délits spécifiques est une première étape, mais à l’heure actuelle aucune condamnation n’a été prononcée pour délit d’entrave à une alerte et l’amende qui sanctionne une plainte pour diffamation abusive est d’une part insuffisante pour être dissuasive et d’autre part très rarement prononcée.
Vers une réforme du statut des lanceurs d’alerte
La transposition de la directive européenne du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union sera l’occasion de procéder à des améliorations indispensables pour rendre le régime français du droit d’alerte pleinement opérationnel et protecteur.
 La proposition de loi va dans ce sens puisqu’elle élargit la définition du lanceur d’alerte en abandonnant le critère de désintéressement (mais en l’absence de contrepartie financière) et celui lié à la gravité des violations susceptibles de faire l’objet de l’alerte. Les faits ainsi dénoncés pourraient être une menace ou un préjudice pour l’intérêt général ou une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international.
La proposition de loi va dans ce sens puisqu’elle élargit la définition du lanceur d’alerte en abandonnant le critère de désintéressement (mais en l’absence de contrepartie financière) et celui lié à la gravité des violations susceptibles de faire l’objet de l’alerte. Les faits ainsi dénoncés pourraient être une menace ou un préjudice pour l’intérêt général ou une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international.
Par ailleurs, la protection accordée aux lanceurs d’alerte devrait être étendue aux « facilitateurs », c’est-à-dire les personnes physiques et morales qui aideraient le lanceur à effectuer son signalement.
Axe d’amélioration important, la procédure de signalement devrait être modifiée et permettre de laisser le choix au lanceur d’alerte entre un canal interne et un canal externe (autorité compétente). La divulgation publique des signalements restera subsidiaire et ne pourra être mise en œuvre qu’en cas d’inertie, de danger imminent pour l’intérêt général ou de risque avéré de représailles.
Enfin, un renforcement de la protection des lanceurs d’alerte est prévu dans la proposition de loi : protection contre les menaces ou tentatives de représailles, élargissement de la définition des représailles pour y inclure la durée du travail, les horaires ou les évaluations, aménagement du régime probatoire, irresponsabilité civile, irresponsabilité pénale pour les facilitateurs, provision pour frais d’instance, sanction plus importante de l’action en justice abusive contre un lanceur d’alerte ou encore un renforcement des attributions du Défenseur des droits.
Le saviez-vous ?
Les entreprises de plus de 50 salariés doivent instaurer un dispositif de recueil et des traitements des alertes respectant les conditions de confidentialité. Mais pour aller plus loin et garantir une véritable indépendance dans le traitement des alertes, la CFTC Cadres vous recommande de négocier le recours à un prestataire extérieur, à une plateforme numérique ou à une cellule éthique indépendante et collégiale afin de préserver au mieux l’anonymat et garantir un traitement plus systématique des alertes. Un retour d’information de l’auteur du signalement sur les suites données nous semble également primordial.
Dans la fonction publique, la plupart des administrations se sont dotées de dispositifs internes efficaces de recueil des alertes et ont fait le choix de confier la qualité de « référent alerte » au référent déontologue (personne physique ou morale). Un point négatif concerne cependant la fonction publique territoriale où on estime que moins de 30 % des collectivités de plus de 30.000 habitants (principalement des communes) respectent cette obligation.
[1] Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
[2] Dispositif comparable en France en matière fiscale pour les « aviseurs fiscaux »
[3] Art. 434-3 du Code pénal : devoir de signalement à l’ensemble des professionnels des établissements sociaux et médico-sociaux
[4] Article L. 4131-1 du Code du travail, issu de la loi du 23 décembre 1982 relative au CHSCT
[5] Lois n°2002-73 du 17 janvier 2002 et n° 2008-496 du 27 mai 2008
[6] Excepté un dispositif particulier pour les sociétés financières soumises au contrôle de l’AMF et de l’ACPR et excepté les faits, informations ou documents couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client.
[7] Art. L. 1132-3-3 du Code du travail
[8] Art. 6 de la loi n°83-643 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
[9] Statistiques collectées par le collectif La Maison des lanceurs d’alerte entre 2018 et 2020
[10] Le scandale LuxLeaks en 2014 a permis de révéler des pratiques d’évitement fiscal agressif dont profitent certaines firmes multinationales
[1] Directive (UE) 2019/1937 du 25 septembre 2019